 « Nous pensions, comme tout un chacun, que la psychiatrie s’occupait des fous, et que c’était là sa mission. Mais nous nous sommes très vite aperçu qu’elle se préoccupait de plus en plus d’autres personnes, par exemple des chômeurs stigmatisés, des cadres placardisés, des mères de famille déprimées, des enseignants méprisés, des jeunes sans avenir, des vieux à l’abandon, bref de (presque) tout le monde. Et que cela provoquait même, en son sein, d’intenses débats (…) sur ses missions, sur le sens de son action dans cette France du XXIe siècle. Un débat, des interrogations qui tournent (…) autour d’un concept : la santé mentale. Un beau mot qui faisait partie du vocabulaire des psychiatres d’après guerre, qui s’étaient donné comme ambition de libérer la folie, de lui rendre sa place au cœur de l’humanité. Et une belle idée aussi, celle d’une psychiatrie ouverte sur le monde, au service de tout le monde. Mais les mots ne portent pas les mêmes sens selon qu’ils sont employés dans un contexte ou dans un autre. Or, derrière ce concept de santé mentale, il y a aujourd’hui une réalité terrifiante, que l’on commence à peine de nommer, celle d’une grande souffrance. En d’autres termes, dans ce monde, les gens souffrent, et ils le font individuellement, pour ainsi dire dans leur coin, comme s’il s’agissait d’une affaire purement personnelle, intime. Nul besoin de faire une investigation poussée pour aller à la rencontre de cette douleur, il suffit de rendre visite aux médecins généralistes, aux psychiatres libéraux ou à ceux du service public, aux centres médico-psychologiques (les CMP) ou aux urgence de l’hôpital, psychiatrique ou non… Cette incursion sur le terrain, comme on dit, permet de répondre à deux questions : cette souffrance existe-t-elle ? Si oui, s’agit-il d’un phénomène massif ? La réponse est oui, elle existe, et oui, elle est massive.
« Nous pensions, comme tout un chacun, que la psychiatrie s’occupait des fous, et que c’était là sa mission. Mais nous nous sommes très vite aperçu qu’elle se préoccupait de plus en plus d’autres personnes, par exemple des chômeurs stigmatisés, des cadres placardisés, des mères de famille déprimées, des enseignants méprisés, des jeunes sans avenir, des vieux à l’abandon, bref de (presque) tout le monde. Et que cela provoquait même, en son sein, d’intenses débats (…) sur ses missions, sur le sens de son action dans cette France du XXIe siècle. Un débat, des interrogations qui tournent (…) autour d’un concept : la santé mentale. Un beau mot qui faisait partie du vocabulaire des psychiatres d’après guerre, qui s’étaient donné comme ambition de libérer la folie, de lui rendre sa place au cœur de l’humanité. Et une belle idée aussi, celle d’une psychiatrie ouverte sur le monde, au service de tout le monde. Mais les mots ne portent pas les mêmes sens selon qu’ils sont employés dans un contexte ou dans un autre. Or, derrière ce concept de santé mentale, il y a aujourd’hui une réalité terrifiante, que l’on commence à peine de nommer, celle d’une grande souffrance. En d’autres termes, dans ce monde, les gens souffrent, et ils le font individuellement, pour ainsi dire dans leur coin, comme s’il s’agissait d’une affaire purement personnelle, intime. Nul besoin de faire une investigation poussée pour aller à la rencontre de cette douleur, il suffit de rendre visite aux médecins généralistes, aux psychiatres libéraux ou à ceux du service public, aux centres médico-psychologiques (les CMP) ou aux urgence de l’hôpital, psychiatrique ou non… Cette incursion sur le terrain, comme on dit, permet de répondre à deux questions : cette souffrance existe-t-elle ? Si oui, s’agit-il d’un phénomène massif ? La réponse est oui, elle existe, et oui, elle est massive.
On comprend mieux, dès lors, pourquoi l’on demande à la psychiatrie de s’en préoccuper. Il ne s’agit pas d’un malaise passager, mais de quelque chose de plus profond et probablement plus durable. Comme le système ne comprend que le langage des chiffres, il a vite fait ses calculs : les dépressions, déprimes, tics et tocs en tout genre coûtent cher à la société – en arrêts de travail, en dépenses de santé -, il faut donc y faire face. Et puis, on ne sait jamais, bien que cette souffrance soit vécue presque toujours comme une affaire personnelle, elle pourrait à la longue perturber le fonctionnement de la machine sociale. Les psychiatres, comme cela a souvent été le cas dans leur histoire – Michel Foucault l’a mis en évidence -, ont ainsi été appelés à la rescousse, et ils doivent accepter désormais le passage « de la psychiatrie à la santé mentale ». En d’autres termes, il va leur falloir s’occuper de M. et de Mme Tout-le-Monde (et, ce faisant, contribuer à la mise en place d’un nouveau contrôle social) et non plus du fou, dont on va jusqu’à nier l’existence. Il s’agit là d’un simple constat, que l’on peut faire à la lecture des textes officiels et des discours dominants, et en étudiant, même superficiellement, les politiques mises en œuvre depuis vingt-cinq ans par les pouvoirs successifs. »
« Cette souffrance touche, même si certains s’ingénient à le nier, à des problèmes économiques et sociaux évidents. On bute toujours sur le chômage, sur la précarité – qui est devenue l’unique horizon pour des millions de citoyens de ce pays -, sur l’exclusion, sur les problèmes de logement, d’éducation, de santé, de culture, de travail, sur tout ce qui concerne le bien public, avec pour conséquence un sentiment d’insécurité généralisé, d’avenir bouché pour soi, pour ses proches et pour ses enfants. C’est bien dans cette situation sociale dégradée que s’enracine cette souffrance. Mais celle-ci ne saurait constituer à elle seule une explication : après tout, nous ne sommes pas dans la première période historique difficile, l’histoire humaine en a connu bien d’autres sans que pour cela l’on ait rencontré ce qui s’exprime aujourd’hui. Il faut donc essayer de se pencher sur les changements qui sont intervenus ces trente dernières années concernant la place de l’individu dans la société. On l’appellera comme on voudra, « montée de l’égoïsme », « individualisme outrancier », au fond peu importe, chacun sent bien que là se joue quelque chose de fondamental, et que la souffrance dont il est question s’enchâsse également dans cette nouvelle réalité. Tous les praticiens qui ont affaire à ces pathologies sont unanimes : derrière chacune, il y a une solitude. Alors certains disent – peut-être non sans raison – que cet isolement est le prix de la liberté conquise par l’individu. On est libre, seul et fragilisé. D’où la souffrance.
Mais faut-il réellement s’en tenir à cette idée d’une « autonomie » conquise par l’individu (contre la société, la famille, les collectifs en général) pour tenter de comprendre ce phénomène ? (…) La conquête de cette autonomie marque toute notre histoire depuis plus de deux siècles et il n’est écrit nulle part qu’elle doive automatiquement conduire à l’abandon et à la souffrance. Il s’agit, au contraire, d’un mouvement irrésistible, porteur, à bien des égards, de progrès et de liberté, qui connaît une fantastique accélération depuis une trentaine d’années. Remettre en cause ce mouvement pour revenir aux anciennes structures sociales – la tribu, le clan, la famille – constitue une absurdité. En revanche, il s’agit de se poser la question des conditions dans lesquelles s’exerce – ou feint de s’exercer – cette autonomie. Ces conditions, créées par le néo-libéralisme dominant, pourraient se résumer à quelques mots. D’abord, la remise en cause de la notion de société : nous vivrions dans un monde composés d’individus autonomes et en compétition (en guerre) les uns contre les autres – en d’autres termes, la société n’existerait plus. Ensuite, ces individus ne seraient pas le résultat d’une histoire, de rapports étroits avec un monde qu’ils contribuent à humaniser tout en s’humanisant, ils seraient des êtres donnés par la nature, avec un potentiel (hier biologique, aujourd’hui génétique) qu’il ne tiendrait qu’à eux de faire fructifier. Ils seraient donc autoconstruits et devraient être capables de s’adapter à l’environnement qui les entoure, sous peine d’être exclus. Ce seraient des individus qui n’ont pas besoin des autres. On voit bien que nous ne sommes plus là dans l’opposition classique individu/collectif, mais dans une vision idéologique – donc discutable – de l’homme et du monde.
Cette vision n’est pas simplement théorique, elle organise réellement notre vie sociale et, pour cela, elle a créé un modèle qui, au final, s’est imposé à toute la société, le modèle de l’entreprise (avec, au cœur de la problématique, le dogme de la concurrence). Non seulement l’école, l’université, l’hôpital, la culture, la mairie ou l’Etat, mais jusqu’à l’individu, qui doit « se gérer » lui-même de cette façon, c’est-à-dire comme une « ressource », comme un capital. C’est la raison pour laquelle nous nous sommes rapidement intéressé à la question de la souffrance au travail. Avec ce soupçon, au départ, que le travail était au cœur du problème. Parce que tout finalement, de près ou de loi, tourne autour de lui. Que l’on soit salarié – c’est-à-dire pourvu d’un emploi -, chômeur ou précaire, on le retrouve directement ou en creux. (…) Celui-ci a été au cœur de la révolte de 68, même s’il s’agissait d’en remettre en cause le caractère aliénant (« métro-boulot-dodo »). Pour cette génération, la libération des individus passait par une libération du travail. Les puissants l’ont bien compris, et dans un premier temps, ils en ont modifié l’organisation pour le rendre plus acceptable, pour laisser entendre à l’individu qu’on allait lui donner plus d’autonomie et de possibilités de s’épanouir. Ce faisant, ils ont réussi à le prendre à son propre piège, l’autonomie se transformant en un assujettissement sans précédent, puis ils ont ensuite escamoté la question du travail : cela ne valait plus la peine de s’en préoccuper puisqu’il était en voie de disparition et que nous entrions dans une autre civilisation, celle du loisir.
Et c’est justement pour cette raison qu’il faut, nous semble-t-il, revenir au travail et l’aborder de nouveau comme une question politique. En premier lieu, parce que les souffrances qu’il inflige aux individus sont au cœur de la souffrance psychique de masse que nous rencontrons aujourd’hui. Ensuite parce que poser la question du travail, c’est poser la question de la vie en général et de la possibilité de la maîtriser, de la changer, comme cela a été fait en 68. (…)
Nous avons préféré (…) donner à voir ce qu’est devenue l’entreprise, c’est-à-dire un lieu où domine désormais l’arbitraire, où l’on ni l’individu, où règne le court terme, où l’on va jusqu’à remettre en cause le métier lui-même, en tout cas le travail bien fait, parce que l’entreprise a été transformé en une « machine à cash » par la prise de pouvoir des actionnaires, une machine dont on finit par se demander si elle n’est pas devenue une institution totalitaire. En fait, on ne peut comprendre le phénomène de la souffrance psychique hors de la souffrance au travail, mais on ne peut comprendre celle-ci sans aller voir de plus près les changements intervenus dans notre société : l’individualisation, la solitude, le recul des protections sociales après l’effondrement des solidarités anciennes, la médicalisation et la psychiatrisation des problèmes sociaux, et, au final, la négation du sujet, au travail et hors de celui-ci. Réhabiliter le sujet, contre un système qui le désavoue et l’étouffe, le remettre au cœur de nos préoccupations, tel est aujourd’hui ce qu’il est urgent d’entreprendre. »
La souffrance psychique en France : un phénomène de masse
« Cela pourrait être le nouveau « mal du siècle », ou un nouveau « jardin des espèces » décrit, à la façon de Prévert, par le sociologue Alain Ehrenberg : « dépression, stress, post-traumatismes, abus sexuels, troubles obsessionnels compulsifs (TOC), attaques de panique, consommation massive de médicaments psychotropes et de drogues multiples (y compris dans le monde du travail), addictions s’investissant dans les objets les plus divers (le jeu, le sexe, la consommation), anxiété généralisée (le fait d’être en permanence angoissé), impulsions suicidaires et violentes (particulièrement chez les adolescents et les jeunes adultes), syndromes de fatigue chronique, « pathologie de l’exclusion », souffrances « psychosociales », conduites à risques, psychopathies… » (…) le monde actuel est confronté à ce que l’on appelle la « souffrance psychique » de masse, c’est-à-dire à l’afflux dans les cabinets de psychiatres et des psychologues, des médecins généralistes, aux urgences des hôpitaux, d’un nombre grandissant de gens angoissés ou déprimés qui y viennent y chercher une aide. »
« Dès le début des années des années 90 [la psychanalyste Marie Pezé] a pu constater les premiers dégâts de ce qu’elle appelle les « changements de modèles organisationnels » – autrement dit les bouleversements qui ont affecté l’organisation du travail dans les entreprises. C’est à cette époque qu’elle remarque une augmentation insensée des cadences – « j’ai vu des ouvrières à qui l’on demandait de visser vingt-sept bouchons à la minute » -, qu’elle découvre le management par la pression morale (avec la parution des premiers guides de management, dans lesquels on explique qu’il faut faire peur aux gens) et les nouvelles formes d’évaluation du travail, avec les entretiens individuels… (…) « Aujourd’hui, pour moi, il ne s’agit plus d’un questionnement : en France, le management a choisi le créneau de la pression morale pour imposer l’intensification du travail ». (…) Après la parution du livre de Marie-France Hirigoyen [Le Harcèlement moral], en 1998, Marie Pezé voit arriver dans son bureau des gens qui se disent « harcelés », terme qu’elle entend non sans une certaine méfiance (…) « mais on s’est vite rendu compte que les gens présentaient des pathologies extrêmement préoccupantes. »Après les TMS [Troubles musculo-squelettiques], suivent en effet les « tableaux psychiques lourds », spécifiques au travail, qui n’existaient pas auparavant : « des cas cliniques absolument épouvantables, des névroses traumatiques qu’on ne rencontre que lors des hold-up dans les banques ou lors des attentats, mais là il s’agissait de personnes qui allait au travail tous les jours à 8 heures du matin, avec la peur au ventre et parfois l’envie d’en finir. »
« Pour [Nicolas Sandret médecin inspecteur du travail], il n’y a aucun doute, la situation en matière de souffrance psychique dans les entreprises connaît une aggravation très importante. Les médecins du travail disent par exemple aujourd’hui recevoir en consultation deux cas psychiques « lourds » par jour, alors qu’il y a encore peu ils n’en recevaient qu’un par semaine. Ces cas sont souvent liés à l’intensification du travail, à une plus grande dureté dans les rapports entre les gens, à une individualisation forcenée, avec un retour à des relations contractuelles pures, à la disparition des espaces d’échanges, de solidarité, de mise en commun des difficultés. « Les salariés sont de plus en plus seuls, explique-t-il, et dès que la situation dérape un peu, elle devient insupportable, alors qu’avant il y avait des lieux où ils pouvaient se retrouver, et donc de résistance collective. » Cette situation s’est aggravée depuis une dizaine d’années, en particulier depuis l’introduction, dans le privé comme dans le public, de l’évaluation individualisée des performances, « qui tend à mettre tout le monde en concurrence avec tout le monde, ce qui fait qu’on ne partage plus, qu’on ne peut plus parler avec les autres, y compris avec la hiérarchie… ». »
« [Une] enquête publiée au début de 2008 montre par exemple « une intensification du malaise ressenti par les salariés, avec une note globale de stress qui atteint 6,3/10, niveau le plus élevé depuis 2004 », comme l’observe Opinion Way. La surcharge de travail est toujours au menu puisqu’elle est ressentie par 78% des personnes, soit une progression de 3% sur 2007 ; 82% des sondés ont le sentiment de travailler plus vite ; 70% disent souffrir d’un manque de reconnaissance, soit 4% de plus qu’en 2007 ; 21% des personnes interrogées disent être confrontées à un harcèlement morale, être en concurrence avec leurs collègues (+ 4%) ; et 14% admettent consommer des médicaments de type antidépresseurs ou anxiolytiques… Ce qui frappe, au-delà des évolutions plus ou moins importantes de ces chiffres, d’un baromètre à l’autre, c’est l’ampleur des phénomènes qu’ils recouvrent. La souffrance au travail – c’est ce ces enquêtes en filigrane laissent apparaître – concerne des centaines de milliers, peut-être des millions, de salariés de ce pays. »
Les nouvelles organisations du travail en cause
« Pourquoi le monde du travail dans les années 70 nous intéresse-t-il aujourd’hui ? Parce que c’est à partir de lui, et pour résoudre la crise qu’il traverse alors, que l’on a revisité la philosophie même de l’entreprise, bouleversé les organisations du travail, et que c’est dans cette brèche que s’est engouffrée la vague néo-libérale des années 80, ce qui a abouti aux problèmes actuels, y compris dans le domaine de la santé mentale. Dès le début de la décennie 70, en effet, les milieux patronaux et gouvernementaux, appuyés par certains intellectuels, se penchent sur cette crise. Dans un premier temps, ils fournissent une réponse classique, en répondant aux demandes de la « critique sociale » avec des avancées extrêmement positives pour les salariés : création du SMIC, quatre semaines de congés payés, mensualisation, droit à la formation continue, interdiction du travail clandestin, généralisation des retraites complémentaires… Mais, très vite, ils se disent que l’on ne peut pas continuer dans cette voie – surtout après les chocs pétroliers, beaucoup estiment que cela coûte décidément trop cher -, que de toute façon cela ne suffit pas et que la crise perdure. Même si la majorité du patronat se montre hostile à tout partage de pouvoir dans l’entreprise – comme en témoigne son opposition déterminée à l’expérience autogestionnaire des ouvriers de Lip en 1973 -, beaucoup pensent qu’il faut s’intéresser à la « critique artiste » et aux idées de Mai 68, et donc se préoccuper de la transformation de l’organisation du travail. (…) Toute cette réflexion se développe sur fond d’affaiblissement du PCF et de la CGT, et donc de la « critique sociale », avec l’émergence d’une « deuxième gauche » politique et syndicale, qui va permettre à la « critique artiste » de s’imposer. Dans les années qui suivent, on assiste donc aux premières expériences de « cercles de qualité », de « groupes de travail », mais, surtout, on modifie petit à petit les organisations pour aller dans le sens d’une plus grande autonomie, l’une des revendications majeures de la « critique artiste ». Cette quête de l’autonomie, au fil du temps, va concerner non seulement les cadres, mais aussi les ouvriers, avec notamment un affaiblissement du contrôle hiérarchique, et les organisations, les services étant désormais considérés comme des unités indépendantes et des centres de profit autonomes. On développe également de plus en plus la sous-traitance. « La remise sous contrôle des entreprises, écrivent Boltanski et Chiapello [dans Le Nouvel Esprit du capitalisme], objectif essentiel du patronat à cette époque, fut obtenue non en accroissant le pouvoir de la hiérarchie […] mais grâce à une rupture avec les modes de contrôles antérieurs… » Les demandes d’autonomie et de responsabilisation, « jusqu’alors jugées comme subversives », sont désormais au cœur de la stratégie des entreprises. « On peut schématiser ce changement, notent encore les deux sociologues, en considérant qu’il a consisté à substituer l’autocontrôle au contrôle et par là à externaliser les coûtes très élevés du contrôle en en déplaçant le poids de l’organisation sur les salariés. » Cela a permis aussi, d’un même mouvement, de se débarrasser des petits chefs et des ouvriers contestataires…
La suite est connue et elle est très bien résumée par Chiapello et Boltanski. « Chocs pétroliers, écrivent-ils, globalisation, ouverture des marchés, montée en puissance de nouveaux pays industriels, nouvelles technologies, changement des pratiques de consommation, diversification de la demande, rapidité croissante du cycle de vie des produits auraient entraîné un accroissement exponentiel des incertitudes de toutes sortes, condamnant à une décadence certaine les systèmes industriels lourds et rigides, hérités de l’ère taylorienne, avec ses concentrations ouvrières, ses cheminées d’usine fumantes et polluantes, ses syndicats et ses Etats-providence. » Cette vision permettra, surtout après le tournant libéral de la gauche en 1983, un consensus sur la flexibilité qui conduira à une précarisation de la main-d’œuvre. Autonomie et flexibilité auront partie liée dans les discours managériaux, la flexibilité étant « synonyme d’adaptation plus rapide aux circonstances locales sans attendre les ordres d’une bureaucratie inefficace ». S’adapter ou périr, telle est la « vision organiciste ou darwinienne » qui sous-tend cette démarche. Les mesures prises par les gouvernements de gauche – amplifiées ensuite par ceux de la « cohabitation » et de la droite – vont souvent dans le sens d’un renvoi des négociations dans l’entreprise, où les sections syndicales sont faibles et les salariés souvent à la merci des directions. C’est le cas par exemple des lois Auroux, qui favoriseront de ce fait la précarisation et l’individualisation des conditions de travail, alors que leur objectif affiché était de favoriser la participation des travailleurs et de renforcer le rôle des syndicats. C’est le cas par exemple de l’abandon de l’indexation des salaires sur les prix avec possibilité d’un rattrapage en fin d’année… dans les négociations d’entreprise. C’est le cas des mesures prises par la droite concernant des facilités nouvelles d’organisation du temps de travail et la suppression de l’autorisation administrative de licenciement… Entre 1982 et 1986, le nombre des accords de branche diminue de moitié, ceux passés dans l’entreprise font plus que doubler. Cette démarche trouvera d’ailleurs son épanouissement avec les lois Aubry instituant les 35 heures, qui ont été un formidable accélérateur de la flexibilité et d’intensification du travail, les négociations dans les entreprises conduisant à un « gagnant-gagnant » le plus souvent défavorable aux salariés : réduction du temps de travail contre flexibilité accrue. (…)
[D]ans les vingt ans qui suivent, on peaufine l’ouvrage : groupes de travail intégrant les salariés, « raccourcissement des lignes hiérarchiques » (autrement dit, moins de chefs et de sous-chefs), déploiement de la certification et de la qualité totale, mise en place du « juste-à-temps », individualisation des rémunérations et mise en concurrence des individus, évaluation annuelle des performances, management par les résultats, utilisation de la sous-traitance (qui permet de se débarrasser de milliers de salariés, souvent les moins qualifiés), recours massif aux CDD et à l’intérim, et donc précarisation de l’emploi, mise en œuvre de l’ « employabilité » et exclusion, chômage massif qui permet de peser sur les salaires et de maintenir les salariés dans la peur… »
« En fait, ces changements ont aussi été rythmés par l’évolution même des marchés. Du temps de Taylor, ceux-ci étaient prévisibles puisqu’il s’agissait de marchés d’équipement. (…) Aujourd’hui, nous avons affaire à des marchés de renouvellement qui ne sont plus aussi prévisibles, à une concurrence mondiale exacerbée, et cela a au moins deux conséquences. La première tient au fait que les entreprises doivent être « réactives » face à une demande changeante et à une offre multiple. Les organisations du travail doivent donc être plus « flexibles », et ce qui va donner le la désormais, c’est la demande du « client ». C’est lui, ce fameux client, qui porte la responsabilité de l’intensification, des changements perpétuels, des « adaptations » sans fin, c’est lui qui fait descendre soudain les contraintes marchandes dans l’atelier, c’est lui enfin qui dédouane les managers de leurs responsabilité dans l’aggravation éventuelle des conditions de travail, puisque c’est « le client » – entité abstraite et insaisissable – qui l’impose. L’autre conséquence de ce « productivisme réactif » tient au fait qu’il n’est désormais plus possible de prescrire le travail dans le détail, comme dans l’organisation taylorienne – fondée sur la parcellisation des tâches et sur la séparation entre la conception et l’exécution -, et que celui-ci nécessite désormais l’engagement du salarié, de son intelligence et de sa subjectivité – ce qui et apparu au départ comme une avancée au regard de l’aspiration à un travail épanouissant, mais qui s’est vite mué en un assujettissement sans précédent. Taylor avait mis la main sur les corps, le nouveau système s’empare également des cœurs et des cerveaux.
Les nouvelles organisations ont donc répondu, au-delà peut-être de leurs espérances, au désir des tenants de la « critique artiste », elles ont mis l’autonomie au cœur de leurs dispositifs. Autonomie des individus – ce qui conduit, avec leur mise en concurrence, à leur isolement et à la remise en cause des collectifs de travail ; autonomie des services, parfois mis en compétition ou dans une relation « client/fournisseur » ; autonomie des équipes, qui peuvent désormais organiser leur travail comme elles entendent. Mais ce que n’avaient probablement pas prévu les « artistes » de 68, c’est que cette autonomie serait parfaitement encadrée et enfermée dans un système qui ne lui laisse aucune marge de manœuvre, en lui imposant des résultats. Et ce système va pousser tellement loin la logique – « Faites comme vous voulez, mais il faut que les objectifs soient atteints » – que le nec plus ultra du management va aboutir dans bien des cas à cette injonction : « Débrouillez-vous ! » Pour parvenir à cela, on a passé quelques décennies à peaufiner les organisations, avec, par-delà les spécificités des unes ou des autres, des constantes. Par exemple, le développement de la polyvalence, c’est-à-dire la capacité pour le salarié, à salaire égal, d’occuper plusieurs postes – après tout, voilà un bon moyen de ne pas mourir idiot, rivé à une seule tâche éternellement -, qui facilite les gains de productivité puisque l’on peut ainsi utiliser le travailleur – la « ressource humaine » ! – là où l’on a besoin. Polyvalence qui suppose la polycompétence : le salarié doit être capable de réaliser des tâches de nature différente, comme la production et le contrôle de la qualité, par exemple. Le travail en équipe représente aussi une pièce maîtresse des nouvelles organisations : le groupe gère son travail comme il l’entend, mais les objectifs collectifs sont très précis et doivent être atteints. Le « juste-à-temps » fait également partie de la panoplie et suppose de réagir très vite à tous les étages de l’entreprise. La satisfaction du client est évidemment l’objectif final déclaré – tant pour les produits que pour les services qu’on lui propose -, et il faut être capable de lui offrir du « sur-mesure » au sein d’une production de masse. Cela passe par le respect de normes de qualité, dans le cadre d’une certification imposant des procédures et cherchant à maîtriser les processus de production, ce qui oblige tout le monde – de haut en bas – à se mettre au diapason de la « satisfaction du client », et donc à se plier.
On voit que le système est très contraignant. Il n’a plus besoin des « petits chefs » pour imposer ses règles, il utilise pour cela, d’une façon intensive, les technologies de la communication, pour faire circuler les informations très rapidement, pour contrôler « en temps réel » le travail effectué, pour faire la chasse aux temps morts, pour maîtriser finement les approvisionnements, l’état des stocks… Il conduit naturellement à une intensification inédite du travail. »
« Flexibilité et autonomie ont conduit à l’intensification du travail, et n’ont pas mis fin au travail répétitif, qui, contrairement à une idée reçue, est en augmentation. Entre 1984 et 1998, le pourcentage de salariés dont le rythme de travail est imposé par le déplacement automatique d’un produit ou d’une pièce est passé de 3 à 6%, ceux qui doivent suivre la cadence automatique d’une machine de 4 à 7%, ceux qui ont des normes de production à respecter en moins d’une heure de 5 à 23%. Parmi les ouvrières qualifiées, 10% travaillaient à la chaîne en 1984, 22% en 1998 ; parmi les non-qualifiés, le pourcentage est passé de 24 à 26, 5%. L’intensification, la dégradation des conditions de travail, l’insécurité dans laquelle vivent de plus en plus de salariés ont conduit à une augmentation sans précédent du nombre d’accidents du travail et de maladies professionnelles. Ainsi estime-t-on à 7 500 le nombre annuel de décès dus à des cancers d’origine professionnelle. 700 personnes meurent chaque année dans des accidents du travail, 600 dans des accidents de trajet (pour le seul régime général de la Sécurité sociale) – en comparaison, 5 000 personnes meurent chaque année dans les accidents de la circulation et 1100 par homicide… En 2003, 48 774 accidents du travail ont conduit à une invalidité partielle (soit 3520 de plus qu’en 1999), 35 000 maladies ont été reconnues (contre 16 700 en 1999) dont 15 700 conduisant à une invalidité (contre 6400 en 1999). Si l’on ajoute à cela les conséquences de la souffrance psychique, on mesure, avec ces chiffres, le coûte que font supporter à la collectivité ces nouvelles organisations du travail…
D’autant plus qu’elles ont aussi conduit à une précarisation de plus en plus grande de l’existence, et pas simplement à cause d’un chômage de masse devenu chronique. En quarante ans, on a fait exploser le Code du travail, on a multiplié les contrats précaires, le recours à l’intérim – présenté il y a encore peu comme la possibilité de vivre libre et de faire des choix, dans le ton de la « critique artiste », mais qui apparaît maintenant pour ce qu’il est réellement : une institutionnalisation de la précarité par des multinationales du maquignonnage -, aux CDD, aux contrats aidés, aux contrats jeunes… On a simplifié les procédures de licenciement, on a permis le recours aux entreprises sous-traitantes qui utilisent une main-d’œuvre précaire, sous-payée, taillable et corvéable à merci, quand elle n’est pas clandestine. Cette précarisation a bouleversé la vie de millions de gens, qui ne peuvent plus désormais penser leur avenir, faire de vrais projets, mais, surtout, elle les a conduits à vivre dans la crainte, voire la peur – ce qui est nuisible à la santé psychique et physique -, et à tout accepter lorsqu’ils ont un emploi. »
« L’entreprise a toujours été un endroit où l’on considérait comme nécessaire de faire des bénéfices, mais on peut avancer que, jusqu’à une période récente, elle était le lieu d’un compromis entre la nécessité d’être rentable et celle de bien travailler. Il y avait donc un double objectif. Aujourd’hui, il n’y en a plus qu’un : gagner de l’argent, le plus possible et le plus vite possible. Cela a des implications bien plus profondes et bien plus graves que l’on ne pourrait l’imaginer, cela signifie – et les témoignages des salariés et des cliniciens le montrent – que le travail lui-même, le travail bien fait, est renvoyé au second rang, et donc de plus en plus remis en cause. S’il est un lieu où la désormais fameuse « valeur travail » est de plus en plus bousculée, abandonnée, niée, c’est bien l’entreprise. »
Un problème politique, et non un phénomène naturel sur lequel on ne pourrait rien
«[L]es souffrances nouvelles qui se répandent dans le monde du travail – et, au-delà, dans la société en général – ont à voir avec le politique. A la base, il y a des choix, même si l’on cherche à tout prix à les masquer, à les travestir par une « naturalisation » des phénomènes, c’est-à-dire par cet a priori (ne supportant aucune discussion) qu’ils relèvent de la nature et non de l’action des hommes, qui n’y pourraient donc rien : naturalisation du marché, naturalisation de l’organisation du travail, naturalisation de la compétition (présentée comme l’une des grandes lois de la nature), naturalisation de la crise – « en ces temps de crise », entend-on dans les médias, comme si l’on disait : « en ces temps de tempête ou de dépression tropicale »-, naturalisation de la concurrence… Cette naturalisation a été, il est vrai, quelque peu écornée par la crise financière de 2008. D’un seul coup, dans le discours public dominant on s’est interrogé sur un système qui serait « devenu fou ». Mais, premièrement, il ne s’agit pas d’un système naturel et parfait qui aurait soudain perdu la tête, il s’agit du système dans son fonctionnement normal de super casino. Deuxièmement, on s’émeut de cette folie parce qu’elle met en jeu des centaines de milliards de dollars, mais personne ne s’est vraiment interrogé sur la « folie » d’un système qui envoie par milliers des gens à la rue, qui génère la souffrance, qui pousse des individus au suicide, qui maintient un milliard d’hommes dans la pauvreté… Une preuve de plus que, dans la « pensée unique » dominante, l’être humain n’existe pas. Troisièmement, le fait que l’on ait assisté à un prétendu retour de l’Etat – en fait, celui-ci n’a pas disparu en ces temps de néo-libéralisme sans frein, il s’est seulement écarté du bien commun pour se mettre, cyniquement, au service exclusif des puissants -, que l’on ait entendu les « grands de ce monde » dire qu’il fallait réinventer un nouveau système financier mondial, afin de mieux le « réguler », montre (à leur corps défendant) qu’il y a bien une possibilité d’intervention humaine sur ces phénomènes « naturels », même dans le cadre d’une mondialisation complexe. Et que, à partir de là, on peut s’en mêler et faire revenir ces questions dans le giron du débat démocratique, dont elles ont été exclues.
Cette naturalisation touche bien sûr le monde du travail. C’est bien le problème de Patrick Légeron [psychiatre et patron d’un cabinet de conseil aux entreprises] : comment faire face au problème de la souffrance – du « stress », dirait-il – sans s’occuper de la « nature » : l’organisation du travail, les objectifs, la concurrence, le marché, la financiarisation de l’économie ? Il le dit lui-même, ce sont des choses auxquelles on ne peut pas toucher, sur lesquelles il est inutile de s’interroger (à moins de fermer les frontières et de revenir à la dictature), et, dès lors, il faut faire avec. En fait, il y a des phénomènes naturels dont lui, les politiques et les directions s’accommodent sans trop de difficultés, ceux qui ne relèvent pas directement de l’entreprise : le marché, la concurrence, la financiarisation. L’entreprise, dit-il, n’a pas le choix, elle doit s’adapter à ce contexte sur lequel elle n’a aucune prise, sous peine de disparaître. (…) Mais il est un phénomène naturel sur lequel l’entreprise peut s’interroger, c’est celui de l’organisation du travail, « les marges de manœuvre, dit Légeron, existent ». Alors, après le déni de la souffrance, voici venu le temps – au fond, on n’a guère le choix – d’une certaine réflexion sur cette fameuse organisation du travail. Celle-ci semble bien aujourd’hui constituer un enjeu politique. D’abord, il y a la volonté de la réduire à une succession de méthodes. Pour illustrer cela, voici comment on « lance » le film de Paul Moreira, Travailler à en mourir, sur une chaîne de télévision : « […] au-delà des impératifs de rendement et des objectifs qu’il faut tenir à tout pris, ce sont bien souvent les méthodes de travail qui rendent malade… » Alors qu’il faudrait inverser la préposition : au-delà des méthodes de travail, ce sont bien souvent les impératifs de rendement et les objectifs qu’il faut tenir à tout prix qui rendent malade (entre autres)… Mais c’est plus simple – et surtout politiquement moins risqué – d’incriminer une « mauvaise » organisation, et si ce n’est qu’une question de « méthode », alors il est possible de faire quelque chose pour empêcher que les gens ne souffrent trop : installer un numéro vers, ménager des pauses, améliorer l’ « écoute des salariés »… « Aménager », comme dit Légeron…
En fait, il ne s’agit pas seulement d’un pis-aller, d’un raccommodage précipité, mais bien d’un début de réponse à un problème qui commence à faire désordre dès lors qu’il ne peut plus être caché – ou qu’il risque de ne pas être accepté. (…) L’organisation du travail ne peut dès lors être considérée uniquement comme une succession de méthodes, un mode d’emploi qu’il suffirait de modifier. Elle est une machine porteuse de sens. A quoi sert-elle fondamentalement ? A fabriquer des produits et à proposer des services pour la collectivité ? Pour les clients de l’entreprise ? A favoriser l’emploi et le développement économique d’une région, d’un pays ? Non, cela c’est de l’histoire ancienne… A favoriser l’épanouissement de ses salariés dans le cadre d’une politique de ressources vraiment humaines ? Absurde… Non, l’organisation du travail est là pour mener une guerre – il n’est qu’à observer le vocabulaire employé : les « troupes », l’ « état-major », la « mobilisation », l’ « assaut du marché »… – une guerre financière mondiale. On a donc changé jusqu’à la finalité même de l’entreprise, que l’on a transformée en « machine à cash ». Toute l’organisation du travail a été repensée dans cette optique. C’est à cela qu’elle sert aujourd’hui, à rien d’autre… On a donc non seulement aggravé, d’une manière inédite, l’exploitation des hommes et des femmes – pour tirer le maximum de profit de leur activité -, mais, pour cela faire, on a changé le travail en le niant, ce qui est nouveau. On ne l’a pas supprimé – il reste un moyen sûr de création de richesses -, mais on a tenté de le contraindre encore plus, de le forcer à se mettre au service exclusif de la folle quête de l’argent, et c’est en ce sens qu’on l’a nié, puisqu’on est allé pour cela jusqu’à reléguer métiers, savoir-faire et travail bien fait – dont on se moque bien évidemment. Et, dans un même mouvement, on a plongé les salariés dans une souffrance inédite. (…)
Tout le monde sait cela, les politiques comme les hauts managers, et comme il est exclu de changer le système, de mettre fin à la course folle dans laquelle nous perdons nos âmes, notre santé, nos vies, alors il faut faire autrement. Et d’abord tenter de définir un objectif réaliste (pour reprendre leur vocabulaire) : non pas mettre un terme aux souffrances – ils savent que cela n’est pas possible si l’on ne touche pas à l’essentiel -, mais banaliser le phénomène en le traitant, comme tous les autres problèmes sociaux aujourd’hui, sous un angle strictement individuel, afin de le faire accepter. »
Médicaliser les problèmes (et culpabiliser les victimes) pour ne pas s’attaquer aux causes
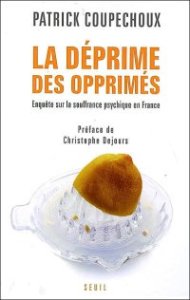 « « Pathologiser » le problème, ce n’est pas seulement envoyer le patient dans les bras du médecin, du psychologue, du psychiatre ou des consultations spécialisées – ce qui fait partie d’une « médicalisation » plus générale de la vie sociale -, c’est remettre au goût du jour des théories anciennes comme celle de l’hygiénisme, qui avait pignon sur rue au XIXe siècle et au début du XXe et qui consiste à considérer la pauvreté (et, plus généralement, les souffrances sociales) comme une maladie. »
« « Pathologiser » le problème, ce n’est pas seulement envoyer le patient dans les bras du médecin, du psychologue, du psychiatre ou des consultations spécialisées – ce qui fait partie d’une « médicalisation » plus générale de la vie sociale -, c’est remettre au goût du jour des théories anciennes comme celle de l’hygiénisme, qui avait pignon sur rue au XIXe siècle et au début du XXe et qui consiste à considérer la pauvreté (et, plus généralement, les souffrances sociales) comme une maladie. »
« En fait, on assiste à une « intoxication » collective, qui prend sa source dans la médicalisation généralisée de l’existence. Celle-ci revêt plusieurs formes, mais, dans ce cas précis, il s’agit de traiter comme des pathologies des problèmes qui ont leur origine dans le fonctionnement même de notre société. C’est la tendance hygiéniste qui revient au premier plan. On en voit tout de suite l’intérêt pour le système. D’une part, il permet de « panser les plaies » et de maintenir les grands équilibres – en d’autres termes, on doit faire face à la souffrance afin que celle-ci n’atteigne pas des niveaux intolérables. D’autre part, cette médicalisation permet au système de se reproduire sans trop de dégâts : tout doit pouvoir continuer, malgré les souffrances et les blessures de plus en plus importantes infligées aux humains. Pendant que l’on « se soigne », on n’interroge pas le monde dans lequel on vit, on ne se pose pas la question de notre capacité à en modifier le cours. Mieux, cette « médicalisation », qui induit une individualisation des problèmes sociaux, permet de faire porter naturellement aux pauvres et aux démunis la responsabilité de leur situation : il est SDF parce qu’il a une personnalité faible et des problèmes personnels ; il est chômeur, c’est parce qu’il n’a pas la force de s’adapter ou de créer son entreprise, parce que c’est un « bras cassé » ; il est pauvre parce qu’il est fragile… Cet aspect politique de la médicalisation de l’existence a probablement été pensé – il est en tout cas largement exploité par le discours public, politique et médiatique. »
Le rôle de la santé mentale : adapter les individus à un système toujours plus violent et inhumain
« Pour faire face à l’intensification, à la pression de l’entreprise, il faut apprendre à « gérer » son temps, à dominer son stress, mieux : à utiliser le bon stress qui nous vient, afin de l’utiliser pour « optimiser » nos compétences et nos résultats. (…) Mais si la personne ne parvient pas à faire cela toute seule, il faut qu’elle aille consulter un expert, médecin, psychologue, psychiatre ou spécialiste de la souffrance au travail, qui lui donnera le coup de pouce dont elle a besoin. Voilà le schéma dont on rêve. Pour que tout cela soit accepté par les intéressés, il faut que ceux-ci aient « intégré » des principes et des normes : on est au service de l’entreprise, et pour cela on doit être performant, et donc en forme, et pour cela il ne faut pas fumer, il ne faut pas boire, il faut manger des légumes et des fruits « cinq fois par jour » (au moins), il faut faire du sport régulièrement (le jogging, c’est bien), goûter aux joies du yoga ou de la thalassothérapie, il faut une vie sexuelle équilibrée et maîtrisée (même un peu diverse, c’est sans problème et c’est bon pour l’accomplissement de soi), il ne faut pas trop s’abrutir dans des lecteurs inutiles (d’ailleurs on n’a pas le temps), il faut agir et ne pas trop penser… A y regarder de plus près, on s’aperçoit que la santé mentale présente deux versants qui sont intimement liés, le premier qui consiste à faire face à la souffrance psychique massive et problématique, le second qui organise la vie des gens afin de les rendre plus performants. D’où la fortune (inespérée) du sport depuis une trentaine d’années. Non seulement parce que l’on a pu en faire un formidable, et donc un extraordinaire business (…), mais aussi parce qu’on l’a érigé en modèle. Le modèle idéal : dans le sport, on s’engage, on se dépasse, on a des « sensations », on ressent des émotions, on s’épanouit, on défend des « valeurs » (particulièrement celle de la saine compétition), et surtout on ne se pose pas de questions, on ne pense pas trop. L’aboutissement logique de tout cela, c’est le dopage, qui concerne à la fois le sport et la société dans son ensemble. La santé mentale, cela sert également à « booster » les individus. Alain Ehrenberg parle d’ailleurs à ce propos de « civilisation du dopage », tandis que R. Gori emploie de son côté le joli terme de « civilisation sportivo-managériale » – c’est bien aussi… »
Patrick Coupechoux, La déprime des opprimés, Enquête sur la souffrance psychique en France, 2009